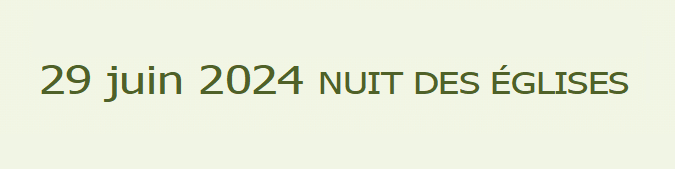2, 4 ou 5 ?
Le Nouveau Testament nous invite à vivre quatre textes de la Passion, un par évangéliste (Marc, Matthieu, Luc et Jean).
Combien de Passions Bach a-t-il écrites ? À en croire son fils Carl Philipp Emanuel et son élève Agricola, les deux auteurs de sa nécrologie, Bach a composé « cinq Passions, dont une pour double chœur ».
Bach s’est penché sur chacun des quatre textes sacrés. Deux partitions nous sont parvenues intégralement : la Passion selon saint Jean, BWV 245 (1724) et la Passion selon saint Matthieu BWV 244 (1727) nécessitant un double chœur. C’est sans doute à cette dernière que la notice nécrologique fait allusion.
Le catalogue de l’œuvre de Bach recense aussi sous la référence BWV 246 la Passion selon saint Luc. Cependant les recherches musicologiques ont rapidement montré que l’attribution à Bach était plus que douteuse, et depuis lors, le catalogue l’a reléguée dans la catégorie « œuvres apocryphes ou anonymes ». Certes, il en existe une copie de la main de Bach datée de 1730 ; mais tout laisse à penser que c’est une copie pour l’usage immédiat.
La cote suivante dans le catalogue concerne la Passion selon saint Marc, BWV 247. Si le livret est conservé, la musique en est hélas perdue. Plusieurs reconstitutions ont été proposées en partant d’autres œuvres du compositeur, style parodique fréquent à cette période, aucune ne s’est révélée concluante.
La musique de la cinquième Passion dont parle la notice reste, à ce jour, égarée. On en connaît cependant le livret, composite, semblant emprunter à des travaux antérieurs du cantor.
Bach à Leipzig
« Puisque nous n’avons pas pu obtenir le meilleur, nous devons nous contenter d’un médiocre ». C’est ainsi que l’un des membres du Conseil de Leipzig a accueilli l’élection de Bach au poste de cantor de Saint-Thomas, le « meilleur » étant pour lui Telemann – auteur de 46 Passions dont aucune n’est restée dans la mémoire de l’Histoire – sinon Graupner, ces deux compositeurs ayant décliné l’offre. Sa fonction y est harassante : son poste musical à Saint-Thomas l’oblige à composer, recopier, diriger ses propres œuvres le dimanche, des Matines aux vêpres. Lui est confiée également la responsabilité d’organiser la musique dans les principales églises de la ville. En outre, il doit enseigner le catéchisme luthérien et le latin, et lui reviennent aussi parfois des séances de surveillance dans cette école de Saint-Thomas qui accueille, dans des conditions rudes, des jeunes déshérités.
Arrivé en 1723, Bach y restera 27 ans, jusqu’à sa mort. C’est pendant cette longue période qu’il compose l’essentiel de ses joyaux sacrés : un nombre considérable de cantates (il doit en préparer une chaque semaine pour l’office du dimanche suivant au moins pendant cinq ans, mais seules nous sont connues celles des trois premières années ; sur les 300 cantates sinon davantage qu’il aurait composées tout au long de sa vie et dont seules 200 nous sont parvenues, au moins 250 dateraient de cette période !) –-, le Magnificat, la Messe en si mineur, l’Oratorio de Noël et les Passions.
Du début à la fin
L’année suivant son installation à Leipzig, Bach est invité à produire une Passion pour être interprétée lors des vêpres du Vendredi Saint en l’église Saint-Nicolas (la proposition d’une Passion annuelle se faisait alternativement dans les deux églises Saint-Thomas et Saint-Nicolas). C’est donc en 1724 que fut terminée et donnée la Passion selon Saint-Jean.
Cependant, le compositeur la remettra sur le métier à plusieurs reprises, la dernière fois en 1749, l’année avant sa mort. Chaque nouvelle mouture a été établie pour que l’œuvre soit adaptée au lieu de l’exécution. Le manuscrit autographe initial ayant été perdu, les interprétations actuelles prennent en compte principalement la version suivante (1725), en se référant autant que faire se peut à la première version pour ce qui est de l’instrumentation, puisqu’on connait les instruments qui étaient à la disposition de Bach en 1724.
Au fil de l’œuvre
D’après le cahier des charges, Bach ne peut composer que de la musique non théâtrale. Pourtant, sa première Passion, traitée en oratorio, relate avec une puissance toute opératique l’action décrite par saint Jean. Bach n’a composé aucun opéra, mais ses deux Passions en sont des témoins à peine détournés.
Le livret n’est pas signé. Bien entendu, le texte de saint Jean, dans sa traduction allemande par Luther, est l’élément principal. Pour les paraphrases qui servent de support aux arias, Bach emprunte à des poètes de l’époque, principalement Brokes (auteur en 1712 d’une « Passion-oratorio » mise en musique par plusieurs contemporains, Telemann et Haendel en étant les plus célèbres).
La Passion selon Saint-Jean est clairement divisée en deux parties. Un tel découpage permettait l’insertion d’une homélie (pouvant durer une heure, paraît-il…) entre les deux. La première partie se termine au reniement de Pierre, la seconde à l’ensevelissement du Christ.
Pour ce qui est du texte biblique, les personnages sont Jésus, Pierre, Pilate, une servante, un garde qui interviennent essentiellement dans les récitatifs. Le chœur prend le rôle des groupes humains (foule, grands prêtres…). Quant à l’Évangéliste, très sollicité, fonction lui est attribuée de raconter et faire défiler l’action. S’y ajoutent les commentaires poétiques mis en musique dans les arias réservés à des solistes qui ne sont pas des personnages bibliques.
La partition est ponctuée de chorals que l’on peut considérer comme les cantiques de la tradition réformée, permettant à l’assemblée de participer à l’office en les chantant. Les mélodies de ces chorals sont puisées dans le répertoire traditionnel, connu par tous les fidèles.
Jean-Clément Jollet
Auteur